[1.04] Tirez pas sur les primaires !
Devenues « machines à perdre » dans l’imaginaire politique français, les primaires (ouvertes ou fermées) ont le dos large alors qu’elles ne sont qu’un outil. Pas toujours bien utilisé, il est vrai.
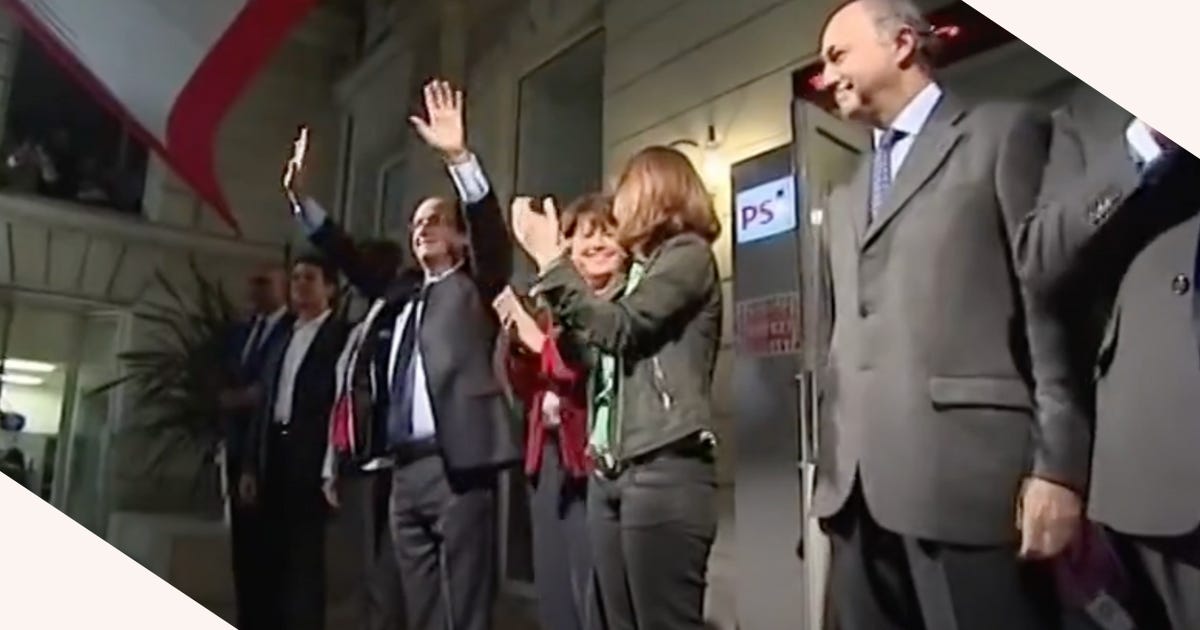
Salut !
C’est le quatrième épisode de Blocs & Partis ! Cette semaine, on parle des primaires. Pas en particulier, mais en général. N’hésitez pas à liker et partager la lettre, c…



